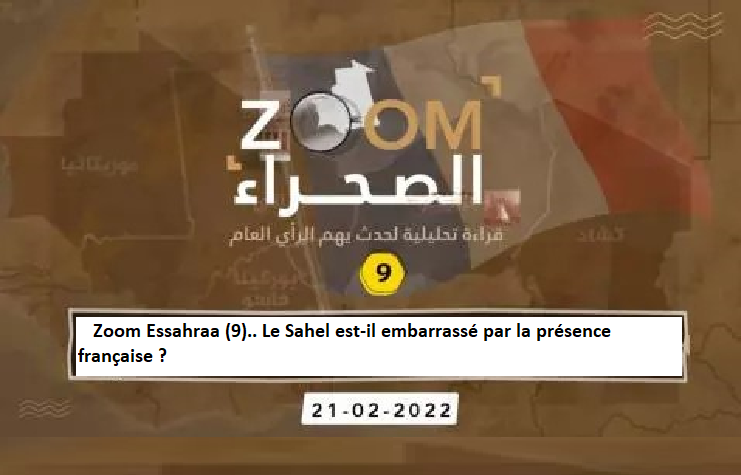
Un état d’allergie à la présence française et un sentiment de dépendance de l’Hexagone se sont constamment faits sentir, au cours des dernières années, dans les régions ouest-africaine et du Sahel.
Les rebondissements de mois passés dans les relations entre Paris et Bamako, qui ont atteint leur paroxysme la semaine dernière, après l’annonce de l’Elysée de son intention de retirer les forces de Barkhane en « bon ordre" et en sécurité et la demande du Mali faite à l’Elysée de se retirer immédiatement, ont conduit les observateurs du dossier des relations franco-africaines à se poser ouvertement la question sous un angle plus profond et plus global.
Quel est l'avenir de la présence française dans la région que Paris considère comme l'une de ses zones d'influence stratégiques ? Quelles sont les raisons qui ont fait écrouler comme un château de cartes et de manière dramatique, une relation vieille de plus de deux siècles ? Le Sahel est-il embarrassé par le déploiement de la France à travers ses Etats et le Sahara accueillera-t-il les bras ouverts d’autres nouvelles puissances internationales… ?
« « «
Les racines du mécontentement
Il est vrai que le Mali est le titre de la crise, mais la vérité aussi, c’est le fait que ce n'est qu'un titre parmi de nombreux autres. Seule l'actualité de ces dernières semaines révèle clairement ce portrait:
- Le président ivoirien Alassane Ouattara s'est exprimé dans une interview accordée à des médias français sur l'existence d'alternatives dans le partenariat économique de la France et de l'Europe, au cas où les Européens ne changeaient pas leur regard sur la nature de la relation et les fondements du partenariat.
- Le chef de l'opposition sénégalaise Ousmane Sonko a inauguré son mandat communal dans la capitale du sud du Sénégal (Ziguinchor), en rebaptisant l’une des rues principales, portant initialement le nom de la France par celui de l'Union africaine.
- La tournée que le président turc Tayyip Erdogan effectue ces jours-ci dans les Etats africains (hier il était au Congo, aujourd'hui il est au Sénégal).
Et bien avant ces nouvelles informations, prévalait un état de grogne contre la France, son héritage et le bilan de la coopération avec Paris, perceptible à travers :
- Un mouvement de jeunesse qui a eu lieu dans les pays d'Afrique de l'Ouest scandant de haute voix, la nécessité de rompre avec l’Hexagone, notamment pour ce concerne les aspects économiques, appelant principalement à rompre le lien entre le CFA et la France,
- Une activité accentuée dans les relations extérieures avec d'autres pays, dont des liens avec la Chine et la Turquie, représentent également les titres les plus en vue dans le domaine économique. Plusieurs analyses avaient mis en évidence les aspects positifs de la relation avec ces deux puissances, malgré la courte durée de ces liens et le fait qu’ils ne souffrent pas de griefs relatifs à la « dépendance » et aux répercussions impérialistes.
- Le troisième facteur a été l'entrée russe sur la ligne, dont le déploiement a atteint l'Afrique de l'Ouest depuis le nord (Libye) et le centre (Centrafrique), avec la restauration de Moscou des lignes et des fils de ses relations de plusieurs décennies avec les élites africaines qui se sont formées en Union soviétique, bénéficiant de l’appui apporté à l’époque par l’ex URSS à la décolonisation.
« «
Retrait ou redéploiement ?
Le président français Emmanuel Macroh a voulu, dans la conférence de presse, au cours de laquelle il est apparu entouré des deux présidents sénégalais (le président en exercice de l'Union africaine) et ghanéen (le président en exercice de la Communauté Eéconomique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO), livrer un message minimisant l’ampleur du fossé entre Paris et Bamako, le résumant en un problème limité avec le Conseil militaire au pouvoir au Mali (il l'a nommé dans la conférence de presse de junte militaire, avec laquelle " dont nous ne partageons ni la stratégie, ni les objectifs cachés"). Mais, il est clair que le problème est plus profond, et c'est ce qu’on peut percevoir à travers les indicateurs suivants :
- L'absence des présidents mauritanien, nigérien et tchadien à la conférence de presse, contrairement aux informations rapportées sans interruption par les médias français au cours des jours précédents.
- La froideur perceptible dans le traitement de plusieurs pays avec les propositions d’accueillir les forces françaises actuellement au Mali (seul le Niger s'est déclaré prêt à recevoir les forces à sa frontière avec le Mali)
Toujours est-il, qu’en dépit des grognements et mécontentements précités, on ne peut accepter sans réserve les analyses hâtives, selon lesquelles les jours de la France dans la région se limitent à ce portrait :
- La situation que conduit à hausser actuellement le ton contre la France dans la région est celle d'un coup d’Etat confronté à des problèmes régionaux et à une opposition interne croissante, malgré sa tentative de se protéger en mettant à profit la ferveur nationale face au colonisateur.
- La présence française dans la région est ancrée culturellement, économiquement et diplomatiquement - et même populairement - de sorte qu'il n'est pas possible de s'en débarrasser aussi facilement comme certains « le souhaitent ».
- Les puissances concurrentes (Chine, Russie, Turquie...) n'ont pas encore la vision ni la capacité qui les rendent capables ou qualifiées pour occuper la place de la France et hériter son influence.
A partir de là, on peut dire - en conclusion - que la crise actuelle des relations franco-maliennes, même si elle représente le prolongement d'une impasse plus forte et plus profonde au Sahel et en Afrique de l'Ouest, ne signifie pas un bouleversement imminent dans l'équilibre de l’influence internationale dans une région qui semble se diriger vers une phase d'instabilité, susceptible de se prolonger et de se diversifier, pour mener généralement vers une réorganisation des relations entre Paris et ses anciennes colonies, dont les traits pourraient se préciser après les élections présidentielles françaises de l'été prochain.





























